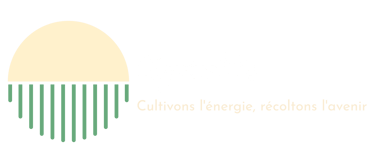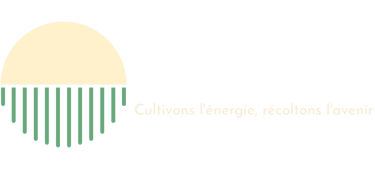Agrivoltaïsme : une proposition de loi pour encadrer et structurer le développement en France
Découvrez la proposition de loi sur l’agrivoltaïsme, adoptée en commission en mars 2025. Encadrement des installations, contribution financière, convention tripartite : un guide pour agriculteurs et développeurs.
RÉGLEMENTATION DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
Demandez à entrer en contact avec un expert agrivoltaïque !
Remplissez notre formulaire de contact en 2 minutes.
Vous serez contacté sous 24H !


L’agrivoltaïsme, combinant production agricole et production d’énergie solaire sur une même parcelle, suscite un vif intérêt en France. Cette solution innovante répond à la fois aux enjeux de transition énergétique et de préservation des terres agricoles. Cependant, son développement rapide soulève des questions sur l’équilibre entre ces deux usages.
Une proposition de loi, déposée le 13 février 2025 par le député Pascal Lecamp et adoptée en commission le 26 mars 2025, vise à poser un cadre juridique clair et raisonné pour l’agrivoltaïsme. Dans cet article, explorons les mesures clés de ce texte et leurs implications pratiques.
1. Des plafonds pour limiter l’impact sur les exploitations agricoles
L’une des mesures phares de la proposition est l’introduction de deux plafonds pour encadrer l’installation de panneaux solaires sur les terres agricoles :
une puissance maximale de 10 MWc par exploitation agricole
une occupation maximale de 30% de la surface agricole utile (SAU) de l’exploitation, avec une exemption pour les parcelles en viticulture ou arboriculture.
Ces seuils visent à préserver la vocation agricole des terres en évitant une emprise excessive des installations photovoltaïques. Pour les agriculteurs, cela garantit que l’activité agricole reste prioritaire. Cependant, la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pourra accorder des dérogations, offrant une certaine souplesse pour des projets spécifiques. Les développeurs devront donc dialoguer étroitement avec cette instance pour adapter leurs projets aux réalités locales.
2. Une contribution financière au service de l’agriculture
La proposition de loi instaure une contribution financière spécifique pour les projets agrivoltaïques, gérée par les chambres d’agriculture. Cette contribution financera des initiatives locales visant :
la structuration économique des filières agricoles
l’adaptation au changement climatique
la transition agroécologique, notamment via des projets alimentaires territoriaux.
Cette mesure est une opportunité pour les agriculteurs, qui pourraient bénéficier de fonds pour moderniser leurs exploitations ou investir dans des pratiques durables. Pour les développeurs, elle renforce l’acceptabilité des projets en démontrant leur apport direct au territoire. Toutefois, le montant de cette contribution, qui sera fixé par décret, reste à préciser, ce qui pourrait influencer la rentabilité des projets.
3. Une convention cadre tripartite pour sécuriser les relations
Un autre point clé est la création d’une convention cadre tripartite obligatoire, signée entre :
le propriétaire de la parcelle
l’exploitant agricole
l’opérateur des installations photovoltaïques.
Ce contrat, d’une durée minimale de 18 ans, devra inclure un bail agrivoltaïque et un cahier des charges définissant les modalités de coexistence entre les deux activités. Cette mesure vise à clarifier les droits et obligations de chacun, tout en sécurisant l’exploitation agricole. Pour les agriculteurs, cela offre une protection contre des usages qui compromettraient leur activité. Pour les développeurs, elle impose une rigueur contractuelle accrue, nécessitant une préparation minutieuse des accords.

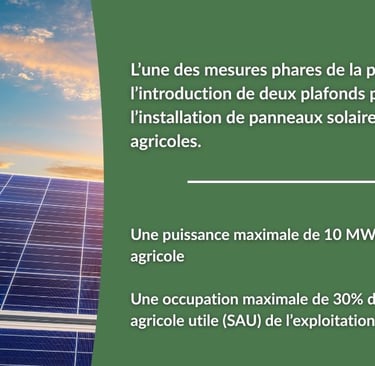
4. Un rôle renforcé pour la CDPENAF
La CDPENAF voit ses prérogatives élargies avec cette proposition de loi. En plus de veiller à une répartition équilibrée des installations solaires sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, elle pourra :
déroger aux plafonds de puissance et d’occupation
adapter les seuils selon les spécificités locales (type de culture, technique photovoltaïque, localisation).
Cette flexibilité est un atout pour répondre aux particularités des territoires, mais elle pourrait aussi introduire une variabilité dans les décisions selon les départements. Agriculteurs et développeurs devront donc s’appuyer sur un dialogue constructif avec la CDPENAF pour faire avancer leurs projets.
5. Des rapports pour anticiper l’avenir
Enfin, la proposition demande au gouvernement de remettre plusieurs rapports au Parlement, notamment sur :
le partage de la valeur générée par l’agrivoltaïsme
l’impact sur le prix du foncier agricole.
Ces études devraient aider à mieux comprendre les dynamiques économiques et foncières induites par l’agrivoltaïsme, offrant aux agriculteurs et aux développeurs des perspectives pour ajuster leurs stratégies à long terme.
En conclusion...
La proposition de loi sur l’agrivoltaïsme, qui a été débattue à l’Assemblée nationale le 1er avril 2025, ambitionne de structurer un secteur en pleine expansion tout en protégeant les intérêts agricoles. Pour les agriculteurs français, elle offre des garanties sur la préservation de leurs terres et des opportunités de financement. Pour les développeurs, elle clarifie les règles du jeu, mais impose de nouvelles contraintes, notamment en matière contractuelle et administrative. Si ce texte est adopté, il marquera une étape décisive vers un agrivoltaïsme raisonné, équilibrant production énergétique et souveraineté alimentaire. Agriculteurs et développeurs devront collaborer étroitement pour transformer ces mesures en opportunités concrètes sur le terrain.