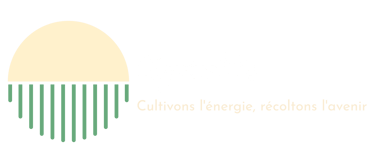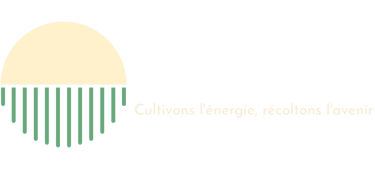Charte départementale pour le développement des installations photovoltaïques au sol en Charente : un cadre clair pour une transition énergétique maîtrisée
Découvrez la charte départementale sur les installations photovoltaïques au sol en Charente, un cadre clair conciliant transition énergétique et préservation des terres agricoles. Agrivoltaïsme, conditions d’installation, objectifs et règles : tout ce qu’il faut savoir.
RÉGLEMENTATION DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
Demandez à entrer en contact avec un expert agrivoltaïque !
Remplissez notre formulaire de contact en 2 minutes.
Vous serez contacté sous 24H !


Face aux enjeux climatiques et à la nécessité d'accélérer la transition énergétique, la Charente s'engage dans un développement ambitieux du photovoltaïque tout en veillant à la préservation des terres agricoles. En décembre 2020, la Chambre d'agriculture de la Charente a adopté une charte départementale encadrant les installations photovoltaïques au sol. Ce document fixe des règles précises pour concilier production énergétique et respect des activités agricoles locales.
Les objectifs de la charte départementale en Charente : concilier développement et préservation
Actuellement, la région Nouvelle-Aquitaine produit 12 200 GWh d’électricité d’origine solaire, soit environ 7,5 % de sa consommation électrique totale. L’objectif fixé par le SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) est d’atteindre 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050, avec une capacité photovoltaïque multipliée par quatre à cinq fois. La charte repose sur quatre grands objectifs stratégiques :
1. Un développement ambitieux de l’énergie solaire
L’initiative s’inscrit dans les engagements nationaux et régionaux visant la neutralité carbone d’ici 2050. Aujourd’hui, la France dispose d’une capacité photovoltaïque installée d’environ 19 GW (gigawatts), avec un objectif national de 100 GW d’ici 2050, soit une multiplication par plus de cinq. La Nouvelle-Aquitaine, région la plus ensoleillée de France après l’Occitanie, joue un rôle clé dans cette transition.
2. Une intégration territoriale et économique des projets
Le développement du photovoltaïque ne doit pas être une démarche isolée. Il doit s’insérer dans les projets de territoire, impliquant les collectivités locales et les citoyens, afin de générer des retombées économiques locales et sociales. En 2022, les énergies renouvelables ont représenté 40 % de l’électricité produite en Nouvelle-Aquitaine, confirmant l’essor de cette filière pour l’emploi local et la réduction des importations d’énergie.
3. Une priorité donnée aux zones artificialisées ou dégradées
La Charente privilégie l’installation des panneaux photovoltaïques sur des toitures de bâtiments agricoles, industriels et résidentiels, ainsi que sur des terrains artificialisés ou dégradés. Aujourd’hui, la France compte plus de 200 000 hectares de friches industrielles et terrains dégradés, offrant un potentiel considérable pour le développement du photovoltaïque sans impacter les surfaces agricoles.
4. Un encadrement strict des installations au sol
Pour préserver les terres agricoles et naturelles, la charte impose des règles strictes pour le déploiement des centrales photovoltaïques au sol. Aucune installation n’est autorisée sur des terrains à vocation agricole, sauf dans le cadre de projets agrivoltaïques respectant des critères rigoureux.


L’agrivoltaïsme : une exception avec des conditions strictes
Si les centrales solaires classiques au sol sont proscrites sur les terres agricoles, une exception est possible pour les projets agrivoltaïques, qui combinent production agricole et production d’énergie. Toutefois, ces projets doivent respecter un cahier des charges strict.
1. Une limitation des surfaces utilisées
Superficie maximale de 30 hectares par projet
Limitation à 30 % de la Surface Agricole Utile (SAU) d’une exploitation
La Charente compte environ 270 000 hectares de terres agricoles, soit 55 % de la surface totale du département
2. Une compatibilité avec l’activité agricole
L’installation ne doit pas empêcher une activité agricole viable et pérenne
Les cultures ou élevages doivent pouvoir coexister avec les panneaux solaires
L’activité agricole doit être maintenue sur toute la durée du projet
À titre d’exemple, en France, plusieurs projets agrivoltaïques montrent des résultats encourageants, notamment dans l’élevage ovin, avec des augmentations de 20 % du rendement fourrager sous les panneaux, grâce à la régulation thermique et hydrique qu’ils apportent.
3. Une installation réversible et respectueuse du sol
Absence d’ancrages en béton ou obligation de retrait en fin d’exploitation
Engagement du développeur à restaurer le terrain après démantèlement
Un projet photovoltaïque a une durée de vie moyenne de 30 ans, nécessitant une planification à long terme pour éviter toute artificialisation définitive des sols.
4. Une juste répartition des revenus entre agriculteur et propriétaire foncier
Partage à 50/50 des revenus issus de l’exploitation du parc photovoltaïque
Garantie de maintien du foncier agricole, même en cas de transmission ou cession
Le revenu moyen issu d’un projet agrivoltaïque peut atteindre 1 500 à 2 000 € par hectare et par an, permettant aux agriculteurs de diversifier leurs sources de revenus.
5. Un suivi rigoureux du projet
Présentation du projet à un comité de suivi avant toute autorisation
Rapport annuel obligatoire détaillant la production agricole et énergétique
En France, plus de 200 projets agrivoltaïques ont été mis en place, avec une volonté d’encadrer et d’accompagner ces initiatives pour en maximiser les bénéfices.
En conciliant énergies renouvelables et préservation des terres agricoles, la Charente se positionne en faveur d’une transition énergétique responsable et concertée, qui bénéficie à l’ensemble de ses acteurs économiques et environnementaux.