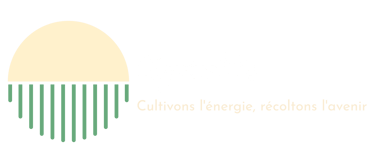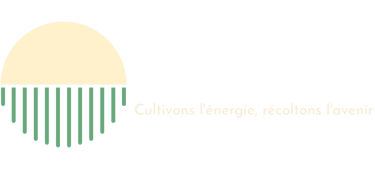Charte photovoltaïque dans le Lot : un engagement territorial pour une transition énergétique maîtrisée
Découvrez la Charte départementale pour le développement des énergies renouvelables dans le Lot : objectifs, chiffres clés et engagements pour une transition énergétique durable. Un guide essentiel pour les agriculteurs et développeurs de projets agrivoltaïques.
RÉGLEMENTATION DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
Demandez à entrer en contact avec un expert agrivoltaïque !
Remplissez notre formulaire de contact en 2 minutes.
Vous serez contacté sous 24H !


Le département du Lot s’engage résolument dans la transition énergétique en définissant une stratégie claire pour le développement des énergies renouvelables, en particulier du photovoltaïque. Signée par l’État, les collectivités et les acteurs socio-économiques, la charte départementale pour le développement du photovoltaïque pose un cadre partagé pour concilier ambition énergétique, préservation des paysages et maintien des activités agricoles.
Un territoire acteur de la planification énergétique
Le Lot ambitionne de devenir un territoire à énergie positive d'ici à 2050, avec une réduction de 40 % de la consommation énergétique actuelle (passant de 4 000 à 2 400 GWh/an) et une production renouvelable en forte hausse (+1 000 GWh/an). Pour y parvenir, le département s'appuie sur un mix énergétique diversifié : solaire, biomasse, méthanisation, hydraulique et éolien, tout en veillant à l'intégration territoriale des projets.
La charte photovoltaïque s’inscrit pleinement dans cette dynamique, en réponse à la hausse des demandes d’implantation d’unités solaires au sol. Elle vise à réguler et accompagner le développement du photovoltaïque de manière concertée, en respectant les enjeux agricoles, environnementaux et paysagers.
Un cadre partagé pour un développement responsable
La charte propose un socle commun de principes pour orienter les projets photovoltaïques au sol, en complément de l’autoconsommation et des installations en toiture :
priorité à la sobriété foncière : les friches, sites dégradés, zones anthropisées et toitures doivent être privilégiés avant toute installation au sol
préservation des sols agricoles : les projets doivent démontrer leur compatibilité avec une activité agricole continue, dans une logique d’agrivoltaïsme réel
réversibilité : les installations doivent pouvoir être démontées à terme, sans compromettre le retour à un usage agricole ou naturel des sols
concertation locale : les collectivités sont pleinement impliquées dès l’amont des projets, tout comme les chambres d’agriculture, les services de l’État, les associations et les citoyens.


L’agrivoltaïsme : une solution d’avenir encadrée
La charte consacre une place spécifique à l’agrivoltaïsme, identifié comme une opportunité lorsqu’il est pensé au service de l’exploitation agricole :
le projet doit améliorer les conditions de production (protection climatique, économie d’eau, bien-être animal…)
l’activité agricole doit rester prioritaire, démontrée et suivie
des engagements contractuels clairs doivent encadrer la répartition des revenus et la gouvernance du projet.
Un outil opérationnel pour les porteurs de projets
Les signataires de la charte s'engagent à :
partager une cartographie des zones propices ou à éviter, en lien avec les documents d’urbanisme
harmoniser les critères d’instruction des projets et réduire les conflits d’usage
favoriser les projets de territoire, portés localement, générateurs de retombées économiques, d’emplois et d’acceptabilité.
Conclusion : un modèle lotois de transition énergétique
La charte départementale photovoltaïque du Lot représente bien plus qu’un simple outil de régulation : elle constitue une boussole collective pour un développement harmonieux du solaire, respectueux des spécificités locales. Agriculteurs, élus, citoyens et développeurs peuvent s’y référer pour concevoir des projets compatibles avec les ambitions écologiques et économiques du territoire.
Source :
Charte départementale pour le développement des énergies renouvelables en Lot - 2021
https://lot.fr/sites/lot.fr/files/chemise_charte_enr_2021_-_215_x_305_pour_email.pdf
Les principes applicables aux projets photovoltaïques
dans le Lot
Les enjeux paysagers
La transition écologique appelle aujourd’hui à concevoir de nouveaux paysages. C'est-à-dire que ce qui a été modelé avec habilité par le passé mérite d’être transformé avec égard pour y intégrer ces nouveaux "équipements". Dès à présent et quel que soit le résultat de la co-construction locale des projets, les signataires de la présente charte s’engagent à prendre en compte plusieurs principes fondamentaux quant à la localisation et à l’échelle des projets.
Deux niveaux de vigilance adaptés au caractère des lieux Sur les sites localisés à enjeu paysager majeur, des projets sont exclus. Il s’agit :
des espaces urbains, des villages et des hameaux
des vallées du Lot, de la Dordogne et du Célé (fonds de vallée, versants, crêtes et rebords de plateaux)
des espaces protégés au titre du Code de l’environnement et des abords de monuments protégés au titre du Code du patrimoine
des espaces hors des espaces protégés mais en covisibilité de monuments protégés au titre du Code du patrimoine en application de l’arrêté du 5 juin 2020 du Conseil d’Etat
des Espaces Naturels Sensibles du Département
des biens UNESCO et de leurs abords directs
des sites à forts enjeux touristiques :
les sites touristiques majeurs et lieux emblématiques d’activités nature (baignades…)
les abords directs des itinéraires de randonnée (GR) valorisés par les offices de tourisme et l’agence de développement touristique, Lot Tourisme
les lieux et les points de vue faisant l’objet d’une valorisation touristique.
Sur l’ensemble du département, des projets feront l’objet d’une vigilance particulière
Considérant que le paysage est une composante essentielle du cadre de vie et de l’attractivité du Lot, sa prise en compte attentive est fondamentale pour l’ensemble des projets d’installation d’unités de production d’énergie photovoltaïque. Sont notamment pré-repérés en raison de leur sensibilité :
les espaces contribuant à la mise en scène des entrées de villes, de villages et de hameaux
les fonds de vallées ou combes, versants, crêtes et rebords de plateaux directement liés à la perception des vallées ou des combes
les zones tampons des biens UNESCO au regard des objectifs de leurs plans de gestion
les espaces en covisibilité des sites protégés au titre du Code de l’environnement
les lieux, les ensembles paysagers et les attributs paysagers identitaires tels que mentionnés dans la Charte du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
les abords de monuments (églises, châteaux) et d’éléments du patrimoine architectural local non protégés en particulier ceux repérés dans le cadre des documents d’urbanisme, repérés dans le cadre d’inventaires publics ou ayant bénéficié d’aides publiques pour leur restauration
les sites touristiques ou d’activité de pleine nature incluant :
les lieux perçus des itinéraires de randonnée : circuit de petite randonnée valorisé dans un guide de niveau départemental et respectant la charte « qualirando », piste équestre labelisée FFE ,...
les abords de sites d’activité touristique, de sites de visite ou de sites de loisir de pleine nature
les itinéraires routiers de découverte ou de liaison touristique,...
Des projets bien insérés dans le paysage local
Les recommandations énoncées ci-dessous prennent une dimension différente au regard de la taille d’un projet. En effet, elles sont du niveau de la préconisation pour les petits projets tandis qu’elles peuvent s’assimiler à une prescription pour les gros projets :
sont considérés comme des "petits projets", les projets d’une superficie inférieure ou égale à 1 ha
les grands projets portent sur des superficies en général supérieures à 5 ha
entre 1 et 5 ha, l’impact étant différent selon les zones géographiques, les documents d’urbanisme devront préciser les conditions d’intégration.
Des perceptions modérées :
projet limitant les co-visibilités lointaines (en toute saison)
unité de production pas ou peu perçue des espaces habités en toute saison (vue de près en particulier)
limitation des perceptions grâce à des masques végétaux réalisés :
soit à l’aide de plantations d’essences locales spontanées
soit par conservation de masses végétales existantes dans l’emprise maitrisée par le porteur de projet (il s’agit de ne pas faire reposer sur des parcelles et des propriétaires extérieurs au projet la responsabilité de sa bonne insertion).
Des équipements connexes de qualité :
clôtures et dispositifs de fermeture discrets (Ex. : couleur neutre, transparence...)
édicules techniques (postes de transformation…) à l’architecture soignée et discrète (ex. : bardage ou habillage bois, couleur neutre...).
Une implantation contextuelle des panneaux et de l’unité de production :
trame d’implantation appuyée sur la structure parcellaire locale
dispositifs épousant au mieux le sol naturel : pas de terrassement modifiant la topographie naturelle
densité aérée permettant le maintien d’une végétation herbacée basse et la circulation nécessaire à l’entretien
implantation en grappes (plutôt qu’un ensemble continu uniforme) : unités séparées par des structures végétales arborées et/ ou arbustives (ex : bandes boisées, haies...).
Enjeux agricoles
De fait, les projets doivent privilégier les sites anthropisés tels les anciennes carrières, les friches industrielles, les délaissés routiers et autoroutiers, les anciennes décharges, les toitures et les parkings. La consommation de surfaces agricoles à l’usage d’installations d’énergies renouvelables, tout particulièrement des centrales photovoltaïques au sol consommatrices de foncier, peuvent constituer un conflit d’usage.
À ce titre, les projets sont exclus :
sur les terrains bénéficiant d’un réseau d’irrigation collectif ou individuel
sur les terres alluviales des vallées principales et des vallées
sur les terrains à vocation agricole à l’exception :
des terrains dont le porteur du projet pourra démontrer l’incapacité à accueillir une activité agricole économiquement viable
des projets agrivoltaïques appuyés par une étude au cas par cas qui devra démontrer de réels bénéfices pour l’agriculture. L’agrivoltaïsme, au sens de la présente Charte, est une combinaison d’un projet de développement agricole et de production photovoltaïque, qui s’entend comme un projet améliorant la production agricole lotoise : soit par une augmentation de la productivité existante, soit par la création d’une production à plus forte valeur ajoutée que celle en place.
Les projets agrivoltaïques devront intégrer la formalisation d’un engagement sur la durée de vie du parc photovoltaïque avec le ou lesdits agriculteurs ; en cas de départ d’un agriculteur, la rétribution contractualisée par l’aménageur sera transférée automatiquement à un nouvel agriculteur qui prendrait la suite. Dans l’intervalle de cette succession, cette rétribution serait versée à l’organisme agricole chargé de monter le nouveau projet d’installation.
Par ailleurs, en fin de vie de l’installation, le terrain d’assiette de l’installation devra conserver son caractère agricole ou retrouver sa vocation agricole initiale (la question de réversibilité est primordiale et devra être conclue entre les parties). Afin d’intégrer ces principes, le porteur de projet devra associer la Chambre d’agriculture bien en amont de sa réflexion pour identifier la synergie possible sur un même site d’une production de photovoltaïque et d’une véritable production agricole.
Enjeux naturels et environnementaux
Un niveau de vigilance adapté à l’intérêt patrimonial des milieux naturels
Afin de garantir la protection d'espaces naturels, les signataires de la Charte demandent que toutes implantations soient exclues des zones protégées ou reconnues pour leur intérêt écologique :
Zones Natura 2000
Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1
Espaces Naturels Sensibles
Zones à forte valeur écologique du PNR des Causses du Quercy (cf. Charte du PNR)
Réservoirs de biodiversité identifiés dans le cadre de la définition de la Trame Verte et Bleue (TVB) des documents de planification urbaine.
Aux côtés de ces espaces naturels de premier plan où prévaut le maintien des modes traditionnels de gestion et d’exploitation, d’autres espaces d’intérêt devront faire l’objet d’une vigilance accrue :
ZNIEFF de type 2 dans lesquelles les implantations ne doivent pas menacer l’équilibre écologique global
Corridors écologiques définis dans le cadre de la TVB des documents de planification urbaine
Corridors écologiques définis sur le territoire du PNR des Causses du Quercy.
Une attention portée au bilan carbone des projets
Le projet devra veiller à ne pas déséquilibrer le bilan carbone du terrain d’assiette grâce à la mise en œuvre de replantations et/ou au maintien d’îlots végétalisés favorables à la biodiversité et à la réduction des impacts paysagers (réduction des effets de masse des installations). En outre, le bilan carbone des panneaux photovoltaïques (tenant compte notamment des modes et lieux de production et des matériaux utilisés) constituera un élément de vigilance au moment de l’appréciation globale du projet.