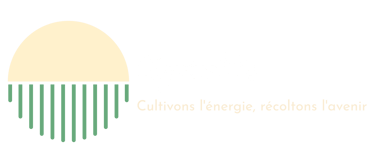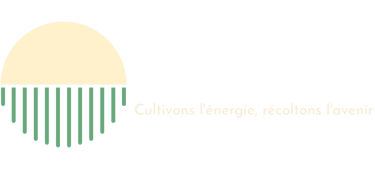Guide pour l'implantation de centrales solaires au sol dans les Hautes-Alpes : des conseils pratiques pour les agriculteurs
Découvrez les recommandations officielles pour implanter des centrales solaires au sol dans les Hautes-Alpes. Un guide complet pour agriculteurs et développeurs agrivoltaïques, avec des conseils pratiques pour concilier énergie renouvelable et préservation agricole.


Face à l’urgence climatique et aux objectifs ambitieux de transition énergétique, le développement des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, est une priorité en France. Dans les Hautes-Alpes, un département marqué par ses paysages montagnards et sa richesse agricole, l’implantation de centrales solaires au sol doit respecter un équilibre délicat entre production énergétique et préservation des terres agricoles, des forêts et de la biodiversité. Dans cet article, explorons les recommandations clés pour réussir l’intégration de ces projets dans ce territoire unique.
Pourquoi choisir les Hautes-Alpes pour un projet photovoltaïque ?
Les Hautes-Alpes offrent un fort potentiel pour le photovoltaïque grâce à un ensoleillement généreux (environ 2 400 heures par an) et des espaces disponibles, bien que contraints par la topographie montagneuse. La PPE fixe un objectif de 32 à 35% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale d’ici 2028, tandis que le SRADDET de Provence-Alpes-Côte d’Azur ambitionne de doubler la production d’énergies renouvelables d’ici 2030.
Cependant, avec 193 885 hectares de surface agricole, dont 64 707 hectares de terres mécanisables ou irrigables (11% du département), et 74,7% du territoire sous protection environnementale, les projets doivent être soigneusement planifiés.
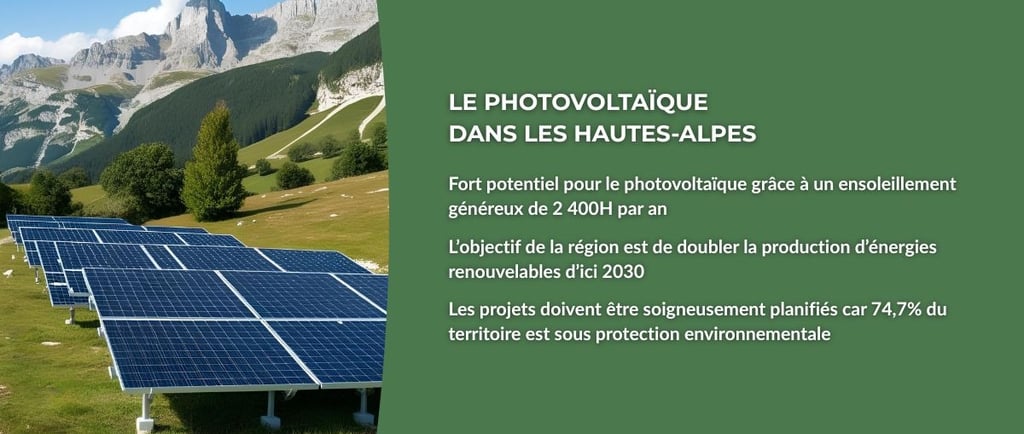

Quels sont les principes d’implantation des centrales solaires dans les Hautes-Alpes ?
1. Privilégier les sites anthropisés et dégradés
Le guide recommande de cibler des terrains déjà artificialisés pour limiter l’impact sur les sols agricoles et naturels. Parmi les sites prioritaires, il y a :
les friches industrielles ou militaires
les anciennes décharges ou sites pollués (BASOL, BASIAS)
les délaissés routiers, ferroviaires ou parkings.
Ces zones, souvent inutilisées, permettent de valoriser des espaces sans concurrencer l’agriculture. Par exemple, des projets sur d’anciens sites industriels peuvent bénéficier de données cartographiques comme CASIAS pour identifier les terrains vacants.
2. Protéger les terres agricoles et les alpages
Les terres mécanisables (11 % du département) et les alpages, qui représentent les deux tiers de la surface agricole, sont stratégiques pour l’agriculture haut-alpine. La loi du 10 mars 2023 interdit l’implantation de centrales solaires sur ces zones, sauf pour des projets agrivoltaïques validés par un document cadre préfectoral. Les terres irriguées (3 à 4% du département) et les zones agricoles protégées (ZAP) comme celles d’Abriès ou Baratier sont également exclues.
Les zones envisageables sont les parcelles incultes ou abandonnées depuis plusieurs années. Elles sont souvent embroussaillées et principalement situées dans le sud du département. Une consultation préalable avec la SAFER est indispensable pour vérifier l’absence de projets agricoles à court terme.
3. Préserver les espaces boisés et naturels
Avec 105 000 hectares de forêts (près de 50 % du département), les Hautes-Alpes abritent des écosystèmes riches. Les forêts à fort potentiel de production, les peuplements matures, ou celles bénéficiant de subventions publiques (Fonds Forestier National) sont protégées. Seuls les boisements récents (moins de 30 ans) ou à faible potentiel peuvent être envisagés, sous réserve d’une expertise forestière et d’une autorisation de défrichement.
Les espaces naturels, couvrant 38,2% du territoire via les sites Natura 2000 et 11,5% en protection forte (zone cœur du Parc national des Écrins), sont également exclus. Les zones humides, essentielles pour la biodiversité, ne peuvent accueillir de projets.
4. Intégrer les enjeux paysagers et naturels
Les projets doivent respecter l’identité paysagère des Hautes-Alpes, un atout touristique majeur. Les sites classés, les périmètres de monuments historiques et les zones UNESCO (Mont-Dauphin, Briançon) sont interdits. Une étude paysagère préalable est requise pour évaluer l’impact visuel et proposer des mesures d’intégration, comme des écrans végétaux ou une adaptation à la topographie.
5. Éviter les zones à risques naturels
Les Hautes-Alpes sont exposées à des aléas forts (avalanches, inondations, incendies). Les secteurs à risque élevé, comme ceux soumis à des crues centennales ou à des incendies en zones non défendables, sont exclus. Une étude de risques est obligatoire pour adapter les projets aux phénomènes naturels locaux.
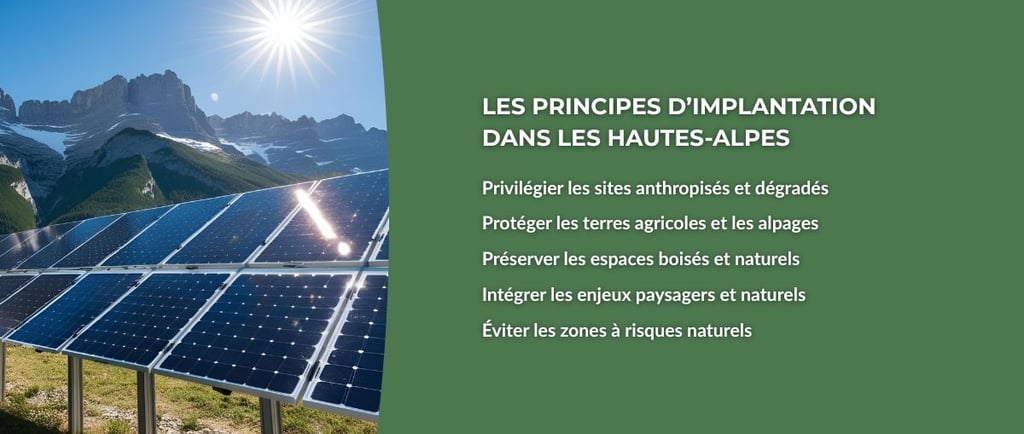
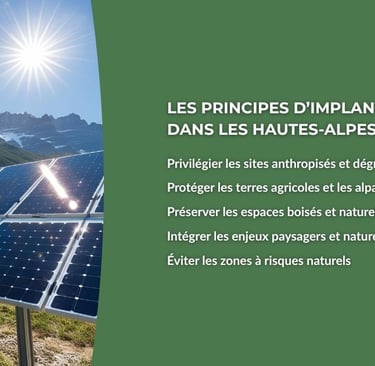
Quelles sont les recommandations pour les agriculteurs
et développeurs agrivoltaïques dans les Hautes-Alpes ?
L'intégration agricole
L’agrivoltaïsme, qui combine production solaire et agricole, est une solution prometteuse. Le pâturage ovin sous les panneaux est souvent proposé, mais sa faisabilité dépend de la ressource fourragère et des contraintes pastorales. Les développeurs doivent collaborer avec les agriculteurs pour évaluer l’impact sur les troupeaux et les équipements pastoraux (points d’eau, accès).
Des mesures environnementales
Pour minimiser l’impact sur la biodiversité, des mesures comme la création de passages pour la faune, la préservation du couvert végétal ou l’installation d’abris pour les espèces locales sont recommandées. Les obligations de débroussaillement (50 mètres autour des parcs) doivent être intégrées dès la conception.
Les aspects réglementaires
Les projets nécessitent un permis de construire, une étude d’impact environnementale et, pour les projets agrivoltaïques, un avis de la CDPENAF. Le guichet-conseil administratif (ddt-guichetconseil@hautes-alpes.gouv.fr) accompagne les porteurs de projets pour naviguer dans ces démarches.
En conclusion...
L’implantation de centrales solaires au sol dans les Hautes-Alpes est une opportunité pour répondre aux objectifs énergétiques nationaux tout en soutenant l’agriculture locale via l’agrivoltaïsme. En suivant les recommandations du guide départemental, agriculteurs et développeurs peuvent concevoir des projets durables qui respectent les terres agricoles, les écosystèmes et les paysages uniques du département.