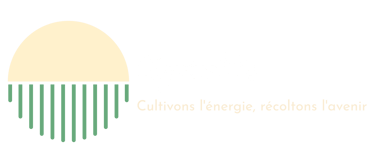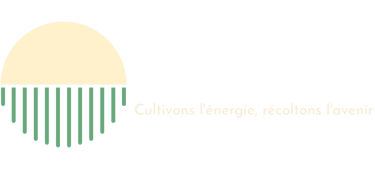Loi sur l’agrivoltaïsme en France : une usine à gaz pour agriculteurs et développeurs ?
Méta-description : La loi sur l’agrivoltaïsme de 2023 et le décret de 2024 encadrent strictement les projets solaires agricoles. Opportunité ou complexité pour les agriculteurs et développeurs ? Découvrez les enjeux et contraintes.
Demandez à entrer en contact avec un expert agrivoltaïque !
Remplissez notre formulaire de contact en 2 minutes.
Vous serez contacté sous 24H !
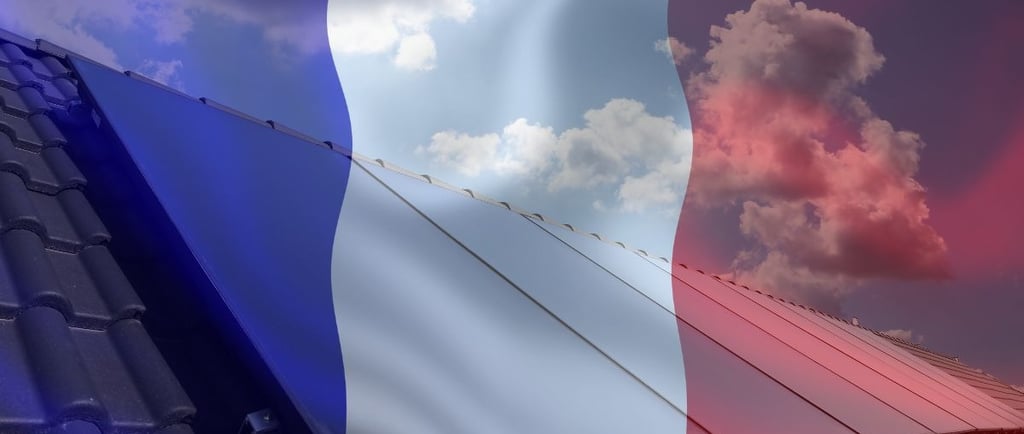

L’agrivoltaïsme, cette pratique qui marie production agricole et énergie solaire sur une même parcelle, suscite un engouement croissant en France. Avec la loi d’accélération des énergies renouvelables (APER) de mars 2023 et le décret d’application du 8 avril 2024, le cadre juridique s’est précisé, mais il soulève une question : est-ce une opportunité pour les agriculteurs ou une usine à gaz administrative ? Cet article s’adresse aux agriculteurs français et aux développeurs de projets agrivoltaïques, confrontés à un cadre réglementaire aussi prometteur que complexe.
Un cadre juridique pour sécuriser, mais à quel prix ?
La loi APER, codifiée dans l’article L. 314-36 du Code de l’énergie, définit l’agrivoltaïsme comme une installation solaire qui contribue durablement à la production agricole tout en apportant au moins un des services suivants : amélioration agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas ou bien-être animal. Le décret de 2024 impose des critères stricts : la couverture des panneaux solaires ne doit pas excéder 40% de la parcelle (sauf dérogations pour projets éprouvés), et la production agricole doit rester l’activité principale, avec une perte de rendement limitée à 10% par rapport à une parcelle témoin.
Pour les agriculteurs, ces mesures garantissent que l’activité agricole prime sur la production énergétique, préservant ainsi la souveraineté alimentaire. Mais elles complexifient les démarches. Les projets doivent désormais passer par la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), qui émet un avis conforme, ajoutant une couche administrative. De plus, le contrôle des rendements et des revenus agricoles, assuré par les Directions départementales des territoires (DDT), demande une rigueur documentaire accrue.
Une opportunité économique freinée par la bureaucratie ?
L’agrivoltaïsme séduit par son potentiel économique. Les loyers versés par les énergéticiens, souvent entre 1 500 et
5 000 € par hectare par an, voire plus, offrent un complément de revenu stable sur des contrats de 25 à 30 ans. Pour les agriculteurs, c’est une bouffée d’oxygène face à la volatilité des prix agricoles. Les développeurs, eux, y voient une solution pour répondre aux objectifs de transition énergétique tout en valorisant des terres agricoles.
Cependant, la proposition de loi de février 2025, portée par Pascal Lecamp, ajoute de nouvelles contraintes. Elle limite les installations à 5 MWc par exploitation (environ 10 hectares) et instaure une contribution financière gérée par les chambres d’agriculture pour soutenir les filières agricoles locales. Si cette mesure vise à redistribuer la valeur, elle suscite des inquiétudes : la FNSEA et la Coordination rurale dénoncent une “architecture rigide” qui risque de décourager les projets naissants.
Comment naviguer dans ce labyrinthe réglementaire ?
Pour les agriculteurs, la clé est de s’entourer d’experts juridiques et techniques dès la conception du projet. Les développeurs, eux, doivent dialoguer avec les CDPENAF pour adapter leurs installations aux réalités locales. La labellisation par l’Afnor, comme celle proposée par France Agrivoltaïsme, peut aussi rassurer sur la conformité des projets. Enfin, anticiper les coûts indirects (fiscalité, adaptation des pratiques agricoles) est crucial pour garantir la rentabilité.
Vers un équilibre entre agriculture et énergie ?
L’agrivoltaïsme reste une opportunité unique pour concilier transition énergétique et résilience agricole. Mais le cadre réglementaire, bien qu’essentiel pour éviter la spéculation foncière, alourdit les démarches. Agriculteurs et développeurs doivent collaborer étroitement pour transformer ces contraintes en leviers de succès, tout en veillant à ce que la production alimentaire reste au cœur des projets.
Sources :
https://www.fermesolaire.fr/magazine/loi-sur-lagrivoltaisme-une-usine-a-gaz-qui-dessert-le-monde-agricole
https://agriculture.gouv.fr/agrivoltaisme-un-cadre-juridique-pour-concilier-production-agricole-et-energie-solaire
https://franceagrivoltaisme.fr/normes-et-labels
https://www.actu-environnement.com/ae/news/agrivoltaisme-nouvelle-loi-2025-contraintes-agriculteurs-45678.php4