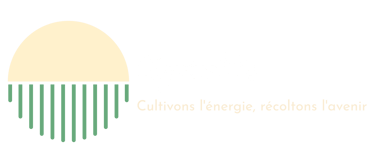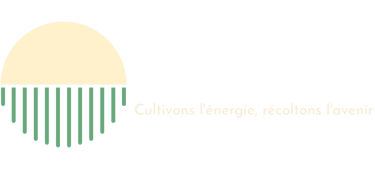Photovoltaïque au sol en Creuse : cadre réglementaire et enjeux pour un développement responsable
La Creuse a mis en place une doctrine stricte pour encadrer les projets photovoltaïques au sol en zones agricoles, naturelles et forestières. Cet article détaille les critères d’implantation, les contraintes environnementales et agricoles, ainsi que les enjeux économiques et énergétiques pour les porteurs de projets.
RÉGLEMENTATION DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
Demandez à entrer en contact avec un expert agrivoltaïque !
Remplissez notre formulaire de contact en 2 minutes.
Vous serez contacté sous 24H !


Dans le cadre de la transition énergétique, la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 fixe un objectif de 33% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique national à l'horizon 2030. Cependant, cette expansion ne doit pas se faire au détriment des activités agricoles et de la biodiversité. Face à l’augmentation des demandes d’installation de centrales solaires au sol, le département de la Creuse a adopté une doctrine stricte afin de préserver son patrimoine rural et naturel tout en favorisant un développement harmonieux du photovoltaïque.
1. Les principes directeurs et l'encadrement des projets photovoltaïques en Creuse
La doctrine, validée par la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en janvier 2023, repose sur plusieurs piliers fondamentaux :
la priorisation des zones dégradées : les projets doivent en premier lieu cibler les friches industrielles, carrières abandonnées et anciennes décharges
la superficie maximale limitée : tout projet photovoltaïque ne doit pas dépasser 30 hectares d'un seul tenant afin d'éviter la fragmentation des paysages
la proximité des infrastructures électriques : les projets doivent se situer à moins de 5 km d'un poste source existant en 2020
la réversibilité et la remise en état : à la fin de vie de l'installation (environ 30 ans), le terrain doit pouvoir être remis à son état initial sans impact durable
la rémunération équitable des agriculteurs : les exploitants doivent percevoir une compensation et l'activité agricole doit rester prépondérante.
2. L'impact et les contraintes des installations photovoltaïques pour les terres agricoles
Les installations photovoltaïques au sol ne doivent pas compromettre le potentiel agricole. Ainsi, tout projet affectant plus d’1 hectare de surface agricole est soumis à une étude préalable agricole (EPA) qui évalue son impact sur les exploitations locales.
Selon la Chambre d'Agriculture de la Creuse, la compensation pour les terres agricoles se calcule selon un ratio économique :
la perte de produit brut agricole multipliée par un coefficient de compensation (fixé à 0,47 pour la Creuse en 2022)
l'investissement minimal de compensation économique fixé à 10 ans de pertes de production, ajusté à la rentabilité de l'exploitation concernée.


3. La préservation de l’environnement et de la biodiversité
Pour limiter l'impact environnemental, plusieurs mesures sont imposées :
la protection des zones humides et des forêts : tout projet en zone humide doit respecter la réglementation « loi sur l'eau » et compenser les dégradations. De plus, les projets en forêt doivent obtenir une autorisation de défrichement avec une compensation écologique.
le suivi des écosystèmes et des paysages : des suivis annuels doivent être réalisés pendant toute la durée d'exploitation pour assurer la préservation des sols, de la faune et de la flore.
un taux de couverture limité à 70% : afin de permettre le maintien d'une activité agricole et de favoriser la rétention des eaux pluviales.
4. Vers un modèle agrivoltaïque adapté au territoire
L'agrivoltaïsme est encouragé dans la Creuse, à condition qu'il respecte les principes suivants :
le maintien d'une production agricole significative sur la parcelle
l'utilisation de systèmes adaptés (panneaux surélevés, rotation des cultures sous les installations, pâturage ovin)
l'association des agriculteurs aux projets dès la phase de conception.
5. Un équilibre entre production d’énergie et intérêts locaux
En Nouvelle-Aquitaine, la puissance photovoltaïque installée a dépassé 3 GW en 2022, avec une augmentation moyenne de 15% par an. La Creuse, grâce à sa doctrine, veille à un développement maîtrisé, limitant la pression foncière et favorisant des solutions intégrées.
En conclusion...
La doctrine départementale de la Creuse constitue un modèle de régulation adapté aux enjeux locaux et nationaux. En conciliant développement énergétique, préservation des terres agricoles et protection de la biodiversité, elle offre un cadre référentiel pour les porteurs de projets souhaitant investir de manière durable dans l'énergie solaire. Les agriculteurs et développeurs doivent s'approprier ces règles pour construire des projets respectueux et bénéfiques à long terme.
Sources :
Doctrine départementale pour les projets photovoltaïques au sol en zone agricole, naturelle ou forestière en Creuse - 10 janvier 2023 :
https://www.creuse.gouv.fr/contenu/telechargement/17905/136440/file/202301_doctrine_CDPENAF_23.pdf
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/R75Et2125/detail