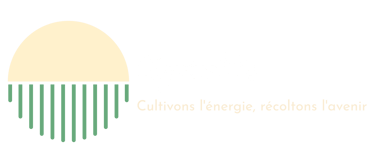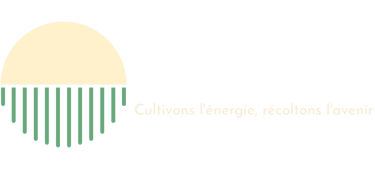Charte agrivoltaïque dans l'Yonne : un cadre de référence pour une coexistence durable
Découvrez la charte agrivoltaïque de l’Yonne : un cadre de référence pour concilier agriculture et production d’énergie solaire. Exigences, financements, protection des exploitants – tout ce qu’il faut savoir pour des projets durables et rentables.
RÉGLEMENTATION DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
Demandez à entrer en contact avec un expert agrivoltaïque !
Remplissez notre formulaire de contact en 2 minutes.
Vous serez contacté sous 24H !


L’agrivoltaïsme est une solution innovante permettant de conjuguer production agricole et production énergétique sur une même surface. Dans l’Yonne, la Chambre d’agriculture a adopté une doctrine professionnelle encadrant ces projets afin de garantir la pérennité des exploitations agricoles tout en contribuant aux objectifs énergétiques nationaux. Cette charte, adoptée le 19 septembre 2024, s’appuie sur la réglementation nationale et apporte des précisions adaptées aux enjeux locaux.
Charte agrivoltaïque en Yonne ou comment assurer la viabilité de l’agrivoltaïsme
Une étude préalable agricole est obligatoire
Tout projet agrivoltaïque doit faire l’objet d’une étude approfondie comprenant :
la description détaillée du projet, la puissance électrique envisagée et les surfaces concernées
l’analyse de l’impact sur les exploitations agricoles existantes
une justification du respect des critères légaux définissant l’agrivoltaïsme
la preuve que la production agricole demeure l’activité principale et génère un revenu durable
une étude pédologique détaillant la qualité des sols
la prise en compte de la transmission des exploitations en cas d’agriculteurs proches de la retraite.
Une étude technico-économique nécessaire
Le projet doit démontrer une rentabilité durable de l’exploitation agricole, indépendamment du revenu lié à l’électricité photovoltaïque. Une évaluation comparative avant et après projet est requise, incluant les marges brutes, l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) sur trois ans et l’impact du projet sur l’économie locale.
Priorité aux sols à faible potentiel agronomique
Les installations sont encouragées sur des terres de faible valeur agronomique (catégories III et IV), selon les outils TYPESOL et WEBSOL. Ces terres sont définies par :
une réserve utile inférieure à 80 mm (prise en compte de la charge en cailloux)
une profondeur d’enracinement inférieure à 60 cm
un rendement moyen théorique en blé inférieur à 70 q/ha.
Pour les terres de meilleure qualité, les projets ne sont acceptés que si l’activité agricole dominante est le maraîchage ou la culture de petits fruits.
La mise en place d’une zone témoin
Chaque projet doit inclure une zone témoin représentant au moins 5% de la surface installée (dans la limite d’un hectare). Celle-ci servira à comparer les rendements agricoles sous panneaux et en plein champ, garantissant ainsi le suivi de l’impact du projet sur l’agriculture.
Un suivi agronomique et économique obligatoire
Sur une période d’au moins 5 ans (renouvelable une fois selon le type d’installation), un organisme indépendant évaluera l’évolution des cultures et des revenus des exploitants. Les résultats devront être présentés à la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers).


2. La protection des exploitants et du foncier agricole
La sécurisation du foncier agricole
Un bail agrivoltaïque (généralement emphytéotique) doit être signé entre le développeur du projet et l’exploitant agricole, garantissant ainsi la pérennité du fermage. En attente de la réglementation nationale définitive, une clause imposera l’adaptation des contrats dès la publication du cadre législatif.
L'exploitation continue des terres
Les parcelles concernées doivent rester exploitées en continu par un agriculteur actif, défini selon l’article D614-1 du Code rural. L’objectif est d’assurer une activité agricole pérenne sur le long terme, sans interruption.
La rémunération minimale des exploitants
L’exploitant agricole doit percevoir une rémunération minimale de 1 500 €/MWc/an, indexée sur le prix de l’énergie.
3. Une répartition équitable de la valeur créée
Un plafonnement de la puissance installée par exploitant
Chaque agriculteur peut bénéficier d’un projet allant jusqu’à 10 MWc, favorisant ainsi un accès équitable aux opportunités agrivoltaïques sans perturber l’équilibre du marché foncier.
La contribution au fonds pour la transition énergétique agricole
Les développeurs doivent verser une contribution annuelle de 1 500 €/MWc/an, destinée à financer des initiatives en faveur de l’agriculture durable.
La participation au fonds de compensation agricole
Une redevance de 5 000 €/ha est exigée pour chaque hectare consommé par le projet hors des parties cultivées sous panneaux. Cette somme est versée au démarrage des travaux pour compenser la perte de terres agricoles productives.


4. Le démantèlement et la restauration des sites
Afin d’assurer la réversibilité des installations, les développeurs doivent constituer une garantie financière de 10 000 €/MWc, déposée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cela garantit que les sites pourront être remis en état après exploitation.
En conclusion...
La charte agrivoltaïque de l’Yonne représente un cadre structurant permettant de concilier production agricole et développement des énergies renouvelables. En posant des exigences strictes en matière de viabilité économique, de protection des agriculteurs et de préservation des terres agricoles, elle offre un modèle équilibré et durable pour les projets agrivoltaïques. Cette doctrine constitue ainsi une référence essentielle pour les acteurs du secteur et un outil d’aide à la décision pour les autorités locales et les professionnels agricoles.
Source :
Doctrine professionnelle de l'Yonne concernant les projets agrivoltaïques - 19 septembre 2024 :
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Bourgogne-Franche-Comte/061_Inst-Bourgogne-Franche-Comte/CA89/DoctrineAgriPV89_VF.pdf