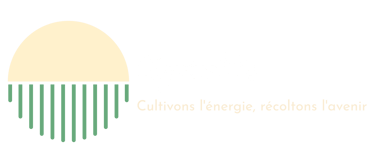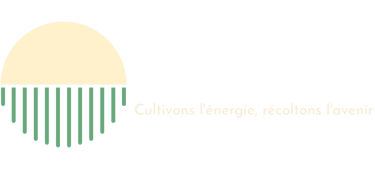Comment sont fabriqués les panneaux photovoltaïques : un guide pour les agriculteurs et les projets agrivoltaïques
Découvrez le processus de fabrication des panneaux photovoltaïques, du silicium au module final et leur rôle clé dans l’agrivoltaïsme pour les agriculteurs français. Un guide complet pour optimiser vos projets solaires.
Demandez à entrer en contact avec un expert agrivoltaïque !
Remplissez notre formulaire de contact en 2 minutes.
Vous serez contacté sous 24H !


L’agrivoltaïsme, qui combine production agricole et énergie solaire, est en plein essor en France. Pour les agriculteurs et les développeurs de projets agrivoltaïques, comprendre la fabrication des panneaux photovoltaïques est essentiel pour évaluer leur qualité, leur durabilité et leur intégration dans les exploitations. Cet article détaille les étapes de production des panneaux solaires, leur composition et leur pertinence pour le secteur agricole.
La matière première : le silicium, cœur des panneaux solaires
La fabrication d’un panneau photovoltaïque commence par le silicium, un matériau semi-conducteur dérivé de la silice, présente dans le sable ou le quartz. Ce composant représente environ 5% d’un panneau, mais il est crucial pour convertir la lumière du soleil en électricité. Le processus débute par la purification du silicium à 99,999999% pour obtenir une qualité optimale. Des fragments de silicium sont mélangés à du bore, qui confère une polarité positive, puis fondus à plus de 1 500 °C dans des fours pour former des lingots. Ces lingots sont ensuite découpés en tranches ultra-fines, appelées wafers, d’une épaisseur d’environ 0,2 mm, équivalent à une feuille de papier.
Cette étape est essentielle, car la qualité des wafers influe directement sur l’efficacité des panneaux. Pour les agriculteurs, cela signifie que des panneaux de haute qualité garantissent une production énergétique stable, essentielle pour l’autoconsommation ou la vente de surplus.
De la cellule au panneau : un assemblage précis
Les wafers sont transformés en cellules photovoltaïques grâce à un traitement antireflet, qui optimise l’absorption de la lumière, et l’ajout de phosphore pour créer un pôle négatif. Chaque cellule fonctionne comme une pile électrique inépuisable, générant un courant continu sous l’effet du soleil. Un panneau classique, mesurant environ 1,7 m x 1 m et pesant 19 kg, est composé de 60 cellules encapsulées entre deux couches de résine transparente pour une protection hermétique.
Un verre trempé de 3 à 4 mm d’épaisseur est ensuite apposé sur la face avant pour protéger les cellules des intempéries, tandis qu’un film de polyester renforce la face arrière. Un cadre en aluminium, conçu pour une résistance mécanique optimale, et une boîte de jonction, qui sert de borne de sortie électrique, complètent l’assemblage. Ces caractéristiques garantissent une durabilité de 25 à 30 ans, un atout pour les agriculteurs investissant dans des installations solaires sur leurs bâtiments ou terrains.


Une production adaptée à l’agrivoltaïsme
Pour les projets agrivoltaïques, les panneaux doivent répondre à des exigences spécifiques. Ils sont souvent installés sur des structures surélevées, comme des ombrières, pour permettre la culture ou l’élevage en dessous. Les panneaux bifaciaux, captant la lumière des deux côtés, sont particulièrement adaptés pour maximiser la production énergétique tout en réduisant l’impact sur les cultures. En France, le décret de 2024 sur l’agrivoltaïsme limite la couverture des panneaux à 40% des parcelles pour préserver un rendement agricole significatif, garantissant ainsi une synergie entre énergie et agriculture.
Les enjeux environnementaux et économiques
Si la fabrication des panneaux nécessite une énergie importante, notamment pour fondre le verre et cristalliser le silicium, les progrès récents réduisent l’empreinte carbone. En Chine, principal producteur mondial, l’énergie utilisée tend à devenir plus verte, avec 35% de la puissance solaire mondiale installée en 2018. De plus, contrairement à une idée reçue, les panneaux au silicium cristallin n’utilisent pas de terres rares, ce qui limite leur impact environnemental.
Pour les agriculteurs, investir dans des panneaux photovoltaïques offre des avantages financiers : autoconsommation pour réduire les factures énergétiques, vente de surplus pour un revenu complémentaire, et subventions comme la prime à l’investissement pour les installations de moins de 100 kWc. Une installation de 200 panneaux de 455 Wc, par exemple, peut générer une prime de 17 290€ et un tarif d’achat de 7,31 centimes par kWh vendu.
En conclusion...
La fabrication des panneaux photovoltaïques, du silicium aux modules finis, est un processus complexe garantissant performance et durabilité. Pour les agriculteurs et les développeurs agrivoltaïques, comprendre ce processus permet de choisir des équipements fiables, adaptés à leurs besoins, et conformes aux réglementations françaises. En combinant production énergétique et agricole, les panneaux solaires offrent une opportunité unique de diversifier les revenus tout en participant à la transition énergétique. Pour optimiser votre projet, consultez un professionnel certifié RGE et explorez les aides disponibles auprès de votre chambre d’agriculture.
Sources :
https://terresolaire.com/Blog/comprendre-le-solaire/panneau-solaire/fabrication-des-panneaux-photovoltaiques/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/reportage-avec-ces-panneaux-solaires-au-dessus-des-cultures-l-agrivoltaisme-est-il-vraiment-l-avenir-de-l-agriculture_6211911.html
https://www.hellio.com/actualites/conseils/agrivoltaisme