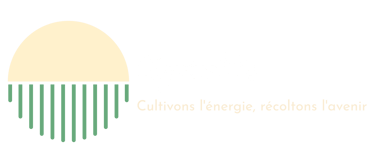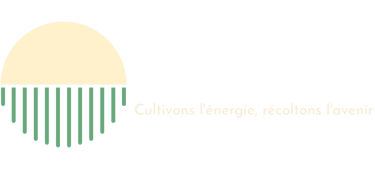Projets photovoltaïques en 2025 : comment transformer les Communes par l’énergie solaire
Découvrez comment les projets photovoltaïques transforment les communes en 2025 : bénéfices économiques, agrivoltaïsme et clés pour réussir. Guide complet pour agriculteurs et développeurs.
Demandez à entrer en contact avec un expert agrivoltaïque !
Remplissez notre formulaire de contact en 2 minutes.
Vous serez contacté sous 24H !


En 2025, les projets photovoltaïques s’imposent comme une solution incontournable pour les communes françaises souhaitant s’investir dans la transition énergétique. Ces initiatives, notamment dans le cadre de l’agrivoltaïsme, offrent des perspectives économiques, environnementales et sociales majeures pour les agriculteurs et les développeurs de projets solaires.
Avec des objectifs ambitieux fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE2) visant une augmentation de 30% de la capacité solaire d’ici 2028, les collectivités territoriales jouent un rôle clé dans le déploiement de ces projets. Cet article explore les enjeux, les avantages et les points de vigilance pour les communes, tout en proposant des conseils pratiques pour maximiser la réussite d’un projet photovoltaïque.
Pourquoi les projets photovoltaïques séduisent les communes en 2025 ?
1. Une réponse aux défis énergétiques et climatiques
Les communes françaises, qu’elles soient rurales ou urbaines, font face à des défis énergétiques croissants, accentués par la flambée des prix de l’électricité (+50,8% des factures mensuelles en 2021, avant le bouclier tarifaire limitant la hausse à 4% en 2022). Les installations photovoltaïques permettent de produire une énergie verte localement, réduisant la dépendance aux énergies fossiles et les émissions de CO2.
Selon l’ADEME, le solaire photovoltaïque ne nécessite pas d’eau pour fonctionner, un atout majeur dans les régions soumises à des stress hydriques. En intégrant des projets agrivoltaïques, les communes peuvent concilier production énergétique et activité agricole, préservant ainsi les terres tout en répondant aux objectifs de la loi Zéro Artificialisation Nette (ZAN).
2. Des retombées économiques significatives
Les projets photovoltaïques génèrent des revenus substantiels pour les communes. Par exemple, une ferme solaire de 10 hectares peut rapporter environ 5 000€ par hectare et par an à un propriétaire foncier, soit 50 000€ annuels pour la commune ou l’agriculteur bailleur.
Ces revenus locatifs, souvent issus de baux emphytéotiques de 18 à 99 ans, offrent une stabilité financière sur le long terme. De plus, les collectivités perçoivent des taxes spécifiques comme l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), la taxe d'aménagement et les taxes foncières, redistribuées entre commune, intercommunalité, département et région. Selon Solaire Conseil, une négociation bien menée peut augmenter les loyers de 30% en moyenne, soit un gain de 400 000€ sur 40 ans pour un terrain de 10 hectares.
Les projets solaires stimulent également l’économie locale. La construction et la maintenance des centrales créent des emplois non délocalisables.
3. Valorisation des terrains inexploités et agrivoltaïsme
Les communes disposent souvent de terrains sous-exploités, comme des friches industrielles, anciennes décharges ou zones délaissées. Ces espaces, parfois inaptes à l’agriculture conventionnelle, sont idéaux pour des centrales solaires au sol ou des ombrières photovoltaïques sur parkings.
L’agrivoltaïsme, en particulier, permet de combiner production d’électricité et activité agricole (élevage, cultures sous panneaux). Par exemple, un projet agrivoltaïque sur 107 hectares de pâturages dans une commune de 300 habitants peut transformer la dynamique locale en générant des fonds additionnels, tout en préservant l’usage agricole des terres.
4. Acceptabilité sociale et implication citoyenne
L’acceptabilité sociale reste un enjeu central. Un sondage OpinionWay de 2022 indique que 42% des Français sont prêts à investir dans des projets citoyens d’énergies renouvelables. Les communes peuvent encourager la participation des habitants via des financements participatifs, comme l’acquisition de parts sociales ou d’obligations via des plateformes comme Lumo. Cela renforce l’adhésion au projet et favorise une gouvernance locale, alignée avec les Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET).


Les points de vigilance pour une mise en œuvre réussie
1. Études de faisabilité et raccordement au réseau
Avant de lancer un projet, une étude de faisabilité est cruciale. Elle évalue l’ensoleillement (irradiance en W/m²), la surface disponible et la distance au poste de raccordement. Par exemple, un poste source trop éloigné peut engendrer des surcoûts importants (jusqu’à 10% du CAPEX, soit environ 80 000€/MWc). En 2024, RTE a dû limiter la production de certaines centrales, comme celle de Cestas, en raison de surcharges réseau, soulignant l’importance d’une planification rigoureuse.
2. Cadre juridique et réglementaire
Les projets photovoltaïques doivent respecter la loi ZAN et les Zones d’Accélération des Énergies Renouvelables (ZAER). Hors ZAER, un comité de projet obligatoire, incluant la commune et les acteurs locaux, peut allonger les délais. Les baux emphytéotiques doivent inclure des clauses claires sur le démantèlement des installations en fin de vie (30-40 ans) pour éviter que la commune ne devienne propriétaire d’une centrale obsolète.
3. Partenariats et négociations
Choisir le bon développeur est essentiel. Nous vous recommandons d’organiser des appels d’offres avec un cahier des charges précis pour sécuriser les meilleures conditions locatives.
En conclusion...
En 2025, les projets photovoltaïques offrent aux communes une opportunité unique de conjuguer transition énergétique, développement économique et valorisation des territoires. Pour les agriculteurs et les développeurs, l’agrivoltaïsme représente une solution durable pour rentabiliser les terres tout en soutenant l’activité agricole.
Cependant, la réussite dépend d’une planification rigoureuse, d’une négociation éclairée et d’une implication citoyenne. En s’appuyant sur des experts comme Agrivoltis et des ressources comme celles de l’ADEME, les communes peuvent transformer leurs projets solaires en véritables moteurs de développement local.